Résumé de la communication du 5 avril 2012
de Mme Marie-Antoinette KUHN, membre titulaire
Le Passionnaire de Philippe de Gueldre,
épouse de René II, duc de Lorraine
Un Passionnaire est un ouvrage qui rapporte les quatre évangiles de la Passion du Christ. Celui qui nous intéresse aujourd’hui appartenait à Philippe de Gueldre, duchesse de Lorraine et seconde épouse de René II, le vainqueur de Charles le téméraire.
Lorsqu’en 1519 Philippe de Gueldre décide d’entrer chez les Clarisses de Pont-à-Mousson elle offre le Passionnaire à leur communauté. Une note autographe apposée sur le plat intérieur de la reliure d’origine précise ce don. Cet ouvrage est aujourd’hui propriété privée.
La couverture, ou plat et contreplat du manuscrit, est en basane, gaufrée, décorée de motifs en relief réalisés avec un fer chaud. On peut reconnaître des motifs floraux ainsi que le monogramme du Christ.
C’est un manuscrit sur vélin. L’écriture est gothique dite littera textualis formata ou lettres de textes en forme. Le texte écrit sur deux colonnes est en latin pour les quatre Evangiles.
L’ouvrage compte 36 pages et 4 enluminures en pleine page. Chaque enluminure introduit un évangile. Le titre est en rouge et la première lettre est une lettrine bleue. On peut constater que le Passionnaire a été beaucoup lu et manipulé : des traces de doigt sont visibles.
Le Passionnaire a été exposé en 1997 : Beauté et pauvreté. L’art chez les Clarisses de France.
Une rubrique lui a été consacrée dans le catalogue : Ecriture et enluminure en Lorraine au Moyen Age, Nancy 1984.
Dans les années 1980, Mme Nicole Raynaud, historienne de la peinture et de l’Enluminure française du XV° siècle, proposait le nom de Hugues de la Faye comme illustrateur du Passionnaire. Ce peintre actif à la cour du duc Antoine entre 1514 et 1539 avait réalisé les dessins préparatoires des peintures pour la Galerie des Cerfs du Palais ducal de Nancy. Selon Mme Raynaud, ce peintre serait aussi l’illustrateur du Songe du Pastourel de Jean le Prieur, chronique relatant la victoire de René II sur Charles le Téméraire à la Bataille de Nancy.
Du fait du mauvais état des dessins conservés à Saint-Petersbourg, les parallèles entre les trois œuvres paraissent aléatoires. Après quelques comparaisons concernant les illustrations du Passionnaire et du Songe du Pastourel, il semble difficile d’attribuer au même peintre, soit à Hugues de la Faye,les peintures de ces deux œuvres.
Si le nom de l’artiste des quatre enluminures du Passionnaire ne peut être affirmé, quelques particularismes peuvent toutefois lui être attribués après examen des illustrations. Il en est ainsi d’une position très particulière de la jambe, du creusement circulaire des plis,des références à une Lorraine investie par la soldatesque, et de la juste interprétation de l’armement de l’époque, de l’émotion qu’il inscrit sur les visages.
Toutefois, plusieurs questions restent posées après l’analyse des enluminures du Passionnaire. Il paraît peu prudent, compte tenu du vide qui existe encore autour de Hugues de la Faye, de trancher quant à l’attribution de cette œuvre à ce peintre. Une quasi certitude quant à la réalisation du Passionnaire dont le commanditaire était peut-être Antoine, fils de Philippe de Gueldre, cardinal évêque de Metz, relève de l’intervention de plusieurs mains ; en somme, il s’agit d’un travail d’atelier, dont Hugues de la Faye était peut-être le maître.
Aucune autre hypothèse n’ayant pu être vérifiée, le nom de Hugues de la Faye peintre à la cour de Lorraine, réalisateur des quatre enluminures sera conservé.

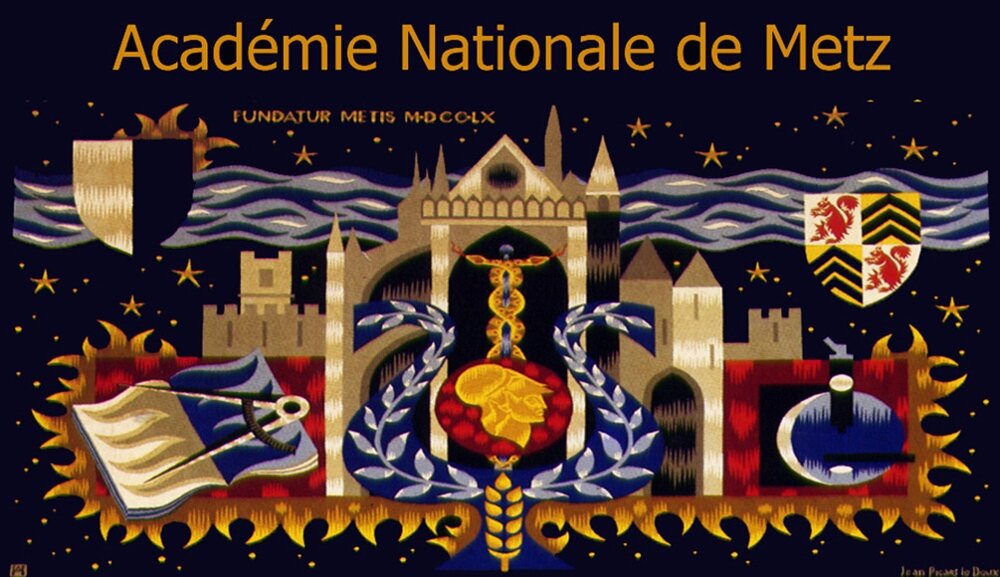
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F17%2F521622%2F73807985_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F07%2F00%2F521622%2F70869939_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F38%2F03%2F521622%2F68759574_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F18%2F521622%2F66263306_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F82%2F521622%2F65219645_o.jpg)










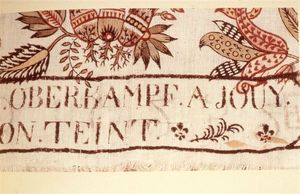

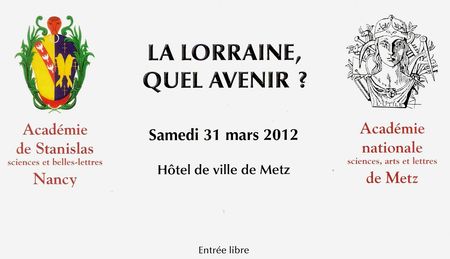







/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F4%2F447145.jpg)